Top albums - mars 2015

Énormément de hip-hop et un soupçon de rock métissé dont les ambitions mélangeuses lorgnent sur le metal, le jazz, la noise ou les musiques du monde, ce classement pourra sembler quelque peu déséquilibré aux yeux des amateurs de pop et d’indie rock canal historique à peine mieux représentés en février. Est-ce à dire qu’en marchant aux coups de cœur partagés on en est forcé d’oublier parfois des disques dont le plébiscite divise au sein de la rédaction, à l’instar du dernier album de Sufjan Stevens resté aux portes de cette sélection ? Même pas, aucun album ne faisant davantage le consensus ici... on mettra donc ça sur le compte d’une conjonction hasardeuse entre qualité, lobbying des uns et des autres et envies du moment, rien de prévisible en somme et c’est bien ça qui fait qu’on ne s’ennuie jamais en commentant mois après mois (pas toujours à l’heure ces temps-ci, faute de disponibilité...) les improbables connexions de ce vote qui fêtera bientôt ses dix ans.
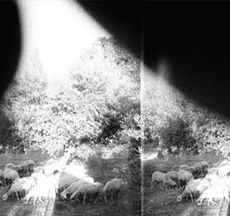 1. Godspeed You ! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress
1. Godspeed You ! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress
"GY !BE attaque ce disque en se plaçant à la croisée des chemins, conjuguant l’univers qui était le sien il y a quinze ans, lorsqu’il dominait sans partage la sphère post-rock ainsi que la révolte et la torpeur qui ont précipité leur retour il y a trois ans.
Pas de grande révolution technique - malgré la confirmation de l’utilisation accrue de drones qui, même étirés sur dix minutes, se renouvèlent et captivent - l’essentiel est ailleurs. Les Montréalais jouent sur l’inattendu. Cordes en contrepoint et crescendos étouffés poignants accompagnent les explosions engendrées par l’unisson des riffs de guitare. Plus que jamais, la nuance est l’un des maîtres-mots de cette nouvelle livraison discographique.
L’urgence (paradoxale pour un disque sorti dix ans après son prédécesseur) et la radicalité de Allelujah ! Don’t Bend ! Ascend ! laissent place ici à une forme évidente de tristesse et à une prise de recul. S’il s’agit de pessimisme, celui-ci est toutefois très modéré. On a ici à faire à une formation qui ne baisse pas les bras bien qu’elle ait conscience de se battre avec des armes moins efficaces que celles de ses assaillants. Bien que moins révolté, Asunder, Sweet And Other Distress est l’album d’un groupe qui n’a pas renoncé à lutter.
Avec Piss Crowns Are Trebled, le clou est enfoncé. Les musiciens marient merveilleusement les cordes qui conféraient à Yanqui U.X.O. sa beauté intrinsèque à la complexité d’une structure entremêlant les couches sonores.
Alors que l’on attendait du collectif, au choix, qu’il enterre définitivement le post-rock en passant à autre chose, ou qu’il le transcende en sortant une nouvelle pierre angulaire du genre, le voici qui s’offre le luxe d’allier ces deux options avec majesté et inspiration."
< lire la suite >
(Elnorton)
 2. Backburner - Eclipse
2. Backburner - Eclipse
"Ce deuxième véritable album du collectif alt-rap d’Halifax reprend les choses là où Heatwave les avait laissées il y a 4 ans sur le même label Hand’Solo, à savoir pile en équilibre entre good vibes funky de nerds en bermuda blindées de grooves rondelets et de name-dropping improbable, et bad trips façon séries B qui jouent à se faire peur en télescopant SF geek, pop culture prépubère, mythes revisités et autres allégories surnaturelles sur fond de tension au cordeau et d’angoisses véritables.
Des madeleines de Proust adolescentes que ravivent les soirées arrosées entre potes (Bottle Caps) aux fantasmes d’excès sans conséquence (le salace Bad Lieutenants) en passant par l’évident mal-être d’inadapté qui sous-tend les spleenétiques Scarecrows et Idea Junkies, un continuel retour vers le futur qui fait donc honneur plus d’une fois au film du même nom (du bien-nommé DeLorean à l’épique Nothin’ Friendly Pt 2 dopé aux cuivres du compositeur Alan Silvestri), réinvente le trap versant gothique engourdi aux chœurs Björkiens d’Homogenic (Goon To A Goblin) ou offre un petit frère hyperactif au coolissime Lifers de l’opus précédent (Death Defy, qui fait de nouveau la part belle au phrasé nonchalant du génial Timbuktu).
Quant au milieu d’album, on y trouve trois tueries sidérales, les effluves orientaux du morceau-titre faisant écho au hip-hop égyptologique de Golden Empire, tandis qu’In The Place s’impose aisément comme le manifeste tardif de cette fine équipe : un festival de couplets de bravoure où surnagent un Jesse Dangerously fou comme feu Ol’ Dirty Bastard, Mister E en surtension d’emblée et décidément trop rare au micro et The Mighty Rhino en guest pour un final au bord du pétage de plombs, Fresh Kils signant pour l’occasion un véritable instru d’anthologie."
< lire la suite >
(Rabbit)
 3. Ghostpoet - Shedding Skin
3. Ghostpoet - Shedding Skin
"Le troisième album d’Obaro Ejimiwe n’est pas celui d’une rupture discographique. Il n’empêche, l’évolution musicale est évidente.
C’est que Shedding Skin est un disque profondément tourné vers l’extérieur là où Some Say I So I Say Light se voulait plus introspectif, l’album faisant alors suite à une rupture délicate. « Ma vie n’en est qu’une parmi des millions d’autres. Et c’est exactement l’état d’esprit de ce disque » indique d’ailleurs le Britannique.
Suivant cette logique, Ghostpoet invite de nombreux artistes, de Melanie De Biasio à Paul Smith (Maxïmo Park), en passant par Lucy Rose ou Nadine Shah, prêtant leur voix. Obaro Ejimiwe s’est également appliqué à mettre en pratique les conseils de compagnons de route aussi prestigieux que Brian Eno, croisé au Mali dans le cadre du projet African Express, qui aurait conseillé à son cadet d’enregistrer ses disques rapidement avant de passer à autre chose.
Une forme d’urgence émerge en effet de Shedding Skin, mais il ne s’agit pas de ce type d’urgence qui hésite avec le cafouillage ou l’empressement. Les instrus hip-hop d’autrefois se font ici plus discrets. L’électricité s’impose comme la force dominante, atteignant son paroxysme au cœur de l’album, sur un Yes, I Helped You Pack dénonçant, sur un versant lorgnant sur le trip-hop industriel, les violences conjugales.
Obaro Ejimiwe parvient à se réinventer sans se renier. Pour autant, ce disque ressemble à son auteur et lui permet de poursuivre l’enrichissement d’une discographie jusqu’à présent parfaite en tous points."
< lire la suite >
(Elnorton)
 4. Billy Woods - Today, I Wrote Nothing
4. Billy Woods - Today, I Wrote Nothing
Des beats urbains dark et oppressants, des boucles d’électro ou de dub nébuleux, des circonvolutions jazzy, pianotages libertaires ou synthés menaçants, une production subtile télescopant sans discontinuer pesanteur et légèreté quasi impressionniste, coolitude et tension, densité et économie de moyens, le tout couronné par un flow ultra-déterminé... c’est minimaliste et plein comme un œuf, inventif et sans concession, sincère jusqu’à la nausée, flirtant par moments avec le chaos pour mieux retrouver l’instant d’après ce sens du tranchant brut et habité qu’on vous vante depuis deux ans déjà, à se demander comment Billy Woods n’est pas encore devenu le nouveau rappeur culte de toute cette génération qui fait doucement le deuil des El-P, Sole et autre Aesop Rock - ce dernier justement aux manettes du futuriste et ténébreux U-Boats en compagnie de Busdriver, si ça c’est pas de l’adoubement !
Pas étonnant que l’étoile montante de l’underground de NYC, bien épaulé sur ce 5e opus par Elucid son compère et producteur d’Armand Hammer - présent sur une poignée de titres de ce Today, I Wrote Nothing - et leur homme de l’ombre Messiah Musik qui en "met en son" la majorité (l’EP Furtive Movements, c’était déjà en partie lui) traînent avec Uncommon Nasa et les Loops Minded Individuals du label I Had An Accident héritier d’Anticon, Vordul Mega des Cannibal Ox mentionnés ci-après ou encore le vétéran Blockhead, producteur phare d’Aesop Rock à la grande époque de Def Jux (et qui signe ici, notamment, un True Stories gothique et irradié d’antimatière comme un bon vieux Can Ox circa 2001). Autant dire que si vous n’aviez pas encore plongé tête la première dans l’univers insaisissable et néanmoins unique du patron de Backwoodz Studioz, il est plus que temps de larguer les amarres !
(Rabbit)
 5. Cannibal Ox - Blade Of The Ronin
5. Cannibal Ox - Blade Of The Ronin
En parlant de tranchant et du Def Jux d’antan, Cannibal Ox retrouve enfin le chemin du cosmos reflété dans les lampadaires des bas-fonds de la grosse pomme avec ce successeur tant attendu de The Cold Vein. Flûtes et synthés baroques y côtoient beats métronomiques et nappes d’orgues gothiques, et ceux qui pensaient que le groupe n’était qu’un véhicule pour le génie d’El-P (en gros ceux qui n’auraient jamais prêté l’oreille à cet absolu chef-d’œuvre de morceau qui réunissait la paire en 2006 sur un chouette album de Vordul en solo) devront sérieusement revoir leur jugement envers ces petits maîtres de la tension en suspension (cf. le parfait Iron Rose).
Pour autant on ne va pas vous faire croire que l’album est parfait, on regrettera d’ailleurs l’absence du meilleur titre de leur Gotham d’il y a deux ans, EP de la résurrection dont Blade Of The Ronin approfondit la mixture de soul post-moderne et de froideur astrale, entre coups de lame cosmogoniques, mysticisme hermétique, odes crépusculaires et caustiques à nos métropoles décadentes et éclats rédemptoires (fabuleux Salvation) sous l’égide du nouveau venu Bill Cosmiq, du collectif de Harlem The Quantum. Ainsi de l’utilisation de ces samples de voix accélérées qui ont pris un sacré coup de vieux ou de claviers spatiaux pas toujours aussi anxiogènes qu’entre les mains expertes d’El-P, du grandiloquent The Fire Rises ou d’un Thunder In July au refrain trop lascif et racoleur pour faire honneur au ton si singulier de Vast Aire et Vordul Mega (attention de ne pas suivre la voie du samuraï Wu-Tang 2.0 ou autant se faire hara-kiri d’emblée !) mais dans l’ensemble et malgré ses longueurs c’est un beau retour que voilà, charriant vindicte fataliste et désespérance sous-jacente au gré des flows au cordeau du duo new-yorkais et de cette tension planante qui sait même se passer de mots sur des interludes tout aussi entêtants (The Horizon).
(Rabbit)
 6. Earl Sweatshirt - I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside
6. Earl Sweatshirt - I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside
Il faut imaginer l’écrasant soleil de la Californie frappant la nuque du jeune Thebe Neruda Kgositsile, épuisant, en même temps que son énergie, tout espoir de futur. Il faut l’imaginer, âgé de 15 ans, seul, désabusé, publiant ses premiers morceaux sur Myspace. Voilà le tableau. Tyler, The Creator le repère, la suite est connue. Il participe à une mixtape du label Odd Future et est contraint à un exil aux Îles Samoa, imposé par une mère effrayée de voir son fils mal tourner. À son retour, il sort Doris, il a 19 ans. Énorme succès. Entouré des meilleurs producteurs du moment, Earl Sweatshirt fait preuve d’une maturité hallucinante sur des titres d’une classe évidente (Chum, Uncle Al, Molasses, et les autres...). S’ensuit une tournée triomphale, accompagné par son mentor, Tyler, The Creator, Earl fait la première partie d’Eminem au Stade de France et gagne une notoriété internationale bien méritée.
C’est dire que ce second album était attendu au tournant. Avec un visuel à la fois très sobre et très sombre, Earl Sweatshirt revient et parvient à répondre aux espoirs suscités par Doris. En refusant toute complaisance, il creuse le même sillon noirci qui l’a amené sur le devant de la scène sans pour autant reprendre les recettes gagnantes du premier jet. En effet, cette fois, il produit lui-même l’intégralité de l’album, sous le pseudonyme Randomblackdude. On n’est pas surpris de découvrir un univers encore plus austère. Plus désespéré que jamais, le flow nonchalant d’Earl Sweatshirt se pose sur des rythmes lents, sourds, déglingués, des morceaux d’orgue affutés, des mélodies de piano obscures, des nappes de sons tâchées... Avec cette esthétique un peu vintage, un peu futuriste (mais d’un futur étrange), on reconnait l’influence de RZA et de MF DOOM sur le rappeur. Elle est pourtant, en même temps, d’une rare authenticité.
On bouge la tête d’avant en arrière, mais au ralenti. Comme pour ambiancer un bad trip choisi lors d’un after enfumé, I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside : An Album by Earl Sweatshirt s’astreint à une lenteur pesante, collante, appuyée, dont on ne ressort pas meilleur, autant se l’avouer. Un album court qui laisse quand même sur la peau une épaisse couche de crasse. Parfait pour refuser de jouir de la chaleur de l’été, pour la supporter dans le noir d’une chambre oubliée, enfoncé dans un canapé usé, loin d’être prêt à affronter le monde.
(Le Crapaud)
 7. Zu - Cortar Todo
7. Zu - Cortar Todo
Depuis plus de quinze ans, les italiens de Zu condensent tous les styles compris entre jazz et pop, en passant par le hardcore et la musique expérimentale contemporaine, autant dire un très large panel, dans des albums pointus et aventureux, toujours curieux et fascinants. Cinq ans après leur première publication chez Ipecac, ce nouvel album, Cortar Todo, le plus direct et accessible qu’il ait jamais produit, marque le retour réussi du trio sur le label de Mike Patton.
Mêlant doom et mathcore pour commencer, Zu s’identifie d’emblée par les sonorités particulières d’une basse saturée, appuyée par les grincements méconnaissables d’un sax baryton truffé d’effets. Ce qui est à la fois original et typique du son de Zu, c’est cette confusion entre les vibrations de la basse et celles du sax. Qu’ils plaquent un riff à l’unisson ou se complètent par leurs interventions respectives, écrites ou improvisées, on est souvent troublé par la proximité de leurs timbres et par l’impression de ne plus savoir à qui l’on a affaire. Toutefois, c’est l’arrivée de Gabe Serbian (déjà présent sur le EP sorti l’année dernière), batteur chez The Locust, qui imprime ce souffle nouveau dans la musique du trio romain.
A Sky Burial est probablement le sommet de l’album. Comme son nom l’indique, c’est un moment de joie intense qui s’ouvre sur une puissante montée, supportée par une batterie au plus free de son jeu, déroulant les roulements démonstratifs mais bien balancés, pour déboucher sur un drone épique, strié des hurlements aigus du saxophone. Un sommet, parce qu’ensuite s’amorce une descente. Une nouvelle facette de Zu. D’abord, on ne se doute de rien, avec Orbital Equilibria, ils offrent une énième salve d’un stoner instrumental à la forme expéditive (morceau court, les parties s’enchaînent sans se répéter), propulsé par un batteur encore grisé de sa précédente performance. Et tout à coup, avec Serpens Cauda, Zu nous plonge dans un autre univers. La rage païenne a laissé place à des chœurs hiératiques. D’une fange abyssale on est élevé en des cieux olympiens. La pochette du disque, rappelant la couverture kitsch d’un roman de science fiction ou une image tirée d’un documentaire écologique apocalyptique, illustre parfaitement ce moment d’extase new wave suranné, qui offre une respiration bienvenue avant que retentisse à nouveau la cloche et que s’ouvre le dernier round.
Ce dernier round, tout aussi puissant que le premier, a l’audace de se conclure, avec Pantokrator, sur un field recording étonnant : les incantations magiques d’un guérisseur indigène, capté par le bassiste Massimo Pupillo lors de ses voyages en Amazonie. Un moment mystique et exotique sur fond de drone noise qui offre une touche chamanique à la musique, décidément ouverte et hors-norme, des Italiens de Zu.
(Le Crapaud)
 8. Pyramids - A Northern Meadow
8. Pyramids - A Northern Meadow
Héraclite disait déjà à peu près qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même disque. Dans celui de Pyramids, on ose à peine se plonger tant il est fluide, sans repère, presque sans structure. C’est comme un flux, un album qui s’écoule sans qu’on puisse s’accrocher nulle part. On y est comme un rondin, passif, à la surface d’un cours d’eau, on se laisse vivre et rien ne s’y construit sinon nous mêmes, à mesure que les accords de guitares s’enchevêtrent et que la voix s’élève comme un passeur fictif.
Ce second album du quatuor texan, sorti chez Profound Lore Records, approfondit la tranchée creusée chez Hydra Head. Revient cet amalgame de guitares saturées dont les riffs se chevauchent, s’entrecroisent, se dispersent, se rejoignent et demeurent toujours en mouvement. Reviennent ces rythmes décousus, encore plus tortueux, de leur nonchalance glaciale. Et cette voix, qui vient d’ailleurs et ne va nulle part, se pose comme un spectre sur ces nuages épais, caresse l’auditeur, l’attendrit (s’éraille moins que sur l’album précédent).
Si elle creuse le même sillon, la musique de Pyramids n’en est pas moins difficile à cerner. Du post-rock, il y en a, teinté de shoegaze. Une brume noise recouvre la base rythmique industrielle. Des plages ambient émergent et disparaissent dans une masse de métal. Inclassable, on ne peut qu’associer Pyramids à la scène occupée par ses collaborateurs récurrents : Colin Marston (Gorguts/Krallice/Dysrhythmia), Vindsval (Blut Aus Nord), Faith Coloccia (Mamiffer), Simon Raymonde (Cocteau Twins), ou autres Jesu, etc. Mais c’est encore manquer la particularité de l’univers onirique et tortueux des Pyramids qui demande, pour se laisser parcourir, un effort spécial.
(Le Crapaud)
Godspeed You ! Black Emperor sur IRM - Site Officiel
Zu sur IRM - Myspace - Site Officiel
Pyramids sur IRM - Myspace - Site Officiel
Cannibal Ox sur IRM
Ghostpoet sur IRM - Myspace
Backburner sur IRM
Earl Sweatshirt sur IRM
billy woods sur IRM

- Sulfure Session #1 : Aidan Baker (Canada) - Le Vent Se Lève, 3/02/2019
- Sulfure Session #2 : The Eye of Time (France) - Le Vent Se Lève, 3/02/2019
- Aidan Baker + The Eye of Time (concert IRM / Dcalc - intro du Sulfure Festival) - Le Vent Se Lève (Paris)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
 Access to Arasaka - Satsuko EP
Access to Arasaka - Satsuko EP Access to Arasaka - Utility EP
Access to Arasaka - Utility EP Jérôme Chassagnard - Asian Breaks EP
Jérôme Chassagnard - Asian Breaks EP Christophe Bailleau O'Farrell - A Version Of Yourself Always Surpasses Death
Christophe Bailleau O'Farrell - A Version Of Yourself Always Surpasses Death Slick Rick - Documents (feat. Nas)
Slick Rick - Documents (feat. Nas) Waxfed - Two
Waxfed - Two Aesop Rock - I Heard It's A Mess There Too
Aesop Rock - I Heard It's A Mess There Too Anatoly Grinberg - Snowing
Anatoly Grinberg - Snowing
 |
 |
 |
- IRM Expr6ss #29 - spécial rap de vétérans : Aesop Rock, Arrested Development, Blueprint, Buck 65, Kool Keith & Ras Kass
- Jérôme Chassagnard - Asian Breaks EP
- IRM Expr6ss #28 - spécial ambient d’octobre : Forest Dweller, K⏣LYDER, Philippe Neau, Jon Porras, Seabuckthorn & VSSP
- Dufourd & Demoulin - Microchimères
- Slick Rick - Victory

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
 |
 |