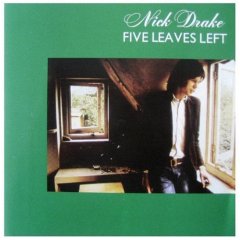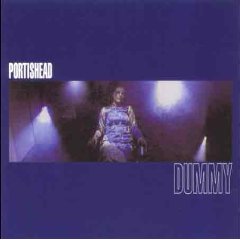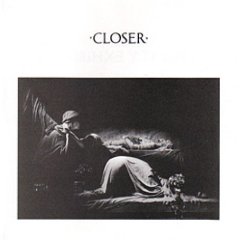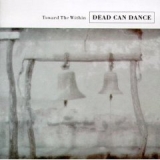100 artistes, 100 albums : les incontournables (Part. 8)

Été 2008, Indie Rock Mag vous propose un dossier incontournable, inédit et indispensable. Prenez un sujet du Forum Indie Rock intitulé "vos 100 meilleurs disques de tous les temps", ajoutez-y une poignée de formules validées par l’INSEE, mixez le tout avec des choix de la rédaction intercalés en parfaite cohabitation et vous voici face à ce que l’on peut considérer comme 100 artistes, 100 albums incontournables (des temps modernes).
15. Nick Drake - Five Leaves Left (UK - 1969)
Le titre Five Leaves Left ne fait aucunement référence à la chute des feuilles à l’approche de l’hiver mais semblerait-il à un message d’avertissement que l’on pouvait lire à l’époque, en 1969, sur les paquets de feuilles de cigarettes. Pourtant on attribue volontiers à cet album un côté automnal de par la mélancolie qu’il dégage et son côté nature, le parfait compagnon des jours de pluie. On imagine aisément Nick Drake, cet anglais de 21 ans, seul, guitare à la main, s’inspirant des tableaux qui forment son quotidien et façonnant ce folk peu courant sur le point de naître. L’exercice scénique n’étant vraiment pas chose facile pour ce jeune homme timide et perturbé, c’est en studio que celui-ci fit ses preuves. Entouré de membres du groupe Fairport Convention, le premier album studio de l’artiste est d’entrée une œuvre remarquable. Nick Drake joue de la guitare sur des rythmes inhabituels, et possède qui plus est une voix fragile et séductrice. Une association au rendu inédit et qui bénéficie sur cet album d’arrangements somptueux et variés de contrebasse, violoncelle, piano ou flûte. Et même si River Man est aujourd’hui un classique, en cette période phare de la musique folk-rock il passa quasiment inaperçu. Et pourtant l’album possède d’autres atouts de charme à faire rougir plus d’une femme et à attendrir plus d’un homme. Une œuvre pleine de romantisme et dotée de petits bijoux tels Cello Song ou Day Is Done.
La presse se montrera tout de même relativement élogieuse sur ce premier essai, tout comme elle le sera pour les 2 albums suivants, Bryter Layter et Pink Moon. Mais le public ne sera jamais au rendez-vous, chacun de ces albums ne se vendant qu’à quelques dizaines de milliers d’exemplaires. Le poète victime de son incapacité à sortir de son studio sombrera dans la déprime et décèdera à 26 ans seulement des suites d’une overdose de médicaments. Ce n’est qu’à titre posthume que ce Five Leaves Left et ses successeurs trouveront enfin la reconnaissance qui leur revient. L’anglais inspirera par la suite de nombreux artistes folk, dont Elliott Smith au destin en partie semblable, et plus récemment le prometteur José González. Abondamment cité en référence donc, mais évidemment jamais égalé. Trente ans après, ce premier album erre dans chacune de nos discothèques telle l’œuvre d’un fantôme qui n’a pas fini de nous hanter.
A lire également notre article "Nick Drake : le magicien n’est plus seul".
Pol
D’un côté Ennio Morricone, le Maestro italien aux multiples facettes auteur de plus de 500 BOs qui l’auront vu quelque part "inventer" le krautrock ou le shoegaze dès le début des années 60 et influencer le post-rock, le trip-hop, l’électronica ou encore des figures aussi essentielles que Radiohead, Isaac Hayes, Gainsbourg, Mike Patton, John Zorn, Pulp ou Sole. De l’autre, Chico Buarque, "The Voice" version brésilienne mais plus encore un songwriter d’une évidence rare et un musicien et arrangeur accompli, capable de métissages proprement insensés entre bossa-nova, pop psychédélique, jazz, samba triste et musique orchestrale (cf. notamment Construção ou sa superbe série homonyme Chico Buarque de Hollanda) - et pourtant, comme nous l’explique The World At Large sur notre forum, il fait partie des arbres qui cachent la forêt du foisonnement des talents brésiliens de l’époque, qui ont inspiré des compositeurs tels qu’Henry Mancini ou Stan Getz (lequel ira même jusqu’à enregistrer des albums et jouer sur scène avec João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Luiz Bonfá ou encore Airto Moreira).
A la fin des années 60, tous deux sont déjà au sommet de leur rayonnement et décident de conjuguer leurs talents le temps d’un album enregistré en deux versions, chantées en italien ( Per un Pugno di Samba ) et en portugais ( Sonho de um Carnaval ). La seconde, légèrement différente dans certains arrangements, ne sortira à l’international qu’en 2000 mais c’est bien celle-ci que nous vous conseillons, pour le naturel de Chico Buarque qui y réinterprète dans sa langue maternelle des chansons souvent issues de ses précédents albums (Samba e Amor, Ela Desatinou, Nicanor, Tema de "Os Inconfidentes"...). Morricone, quant à lui, se réapproprie la musique brésilienne et lui injecte au passage son sens du baroque, son lyrisme désespéré et sa mélancolie hantée, appuyée par celle du chant toujours aussi caressant et spleenétique de Chico Buarque, mais aussi un peu de truculence notamment dans les morceaux plus "salsa" pour déjouer cette sensation tourmentée qui domine. Ici des arrangements de violons évanescents et douloureux préfigurent l’un des scores les plus connus du Maestro pour Sergio Leone, Il était une fois la Révolution, là des voix féminines éthérées, presque abstraites, rappellent ses BO horrifiques pour Dario Argento, le poignant Nao Fala de Maria égale Nick Drake sur son terrain, mais déjà le clavecin en roue libre, les cuivres majestueux, les cordes martiales et les percées d’un orgue au second plan sur l’indépassable Roda Viva d’ouverture donnaient le ton : le "son Morricone" ne s’est pas perdu en route, pas plus que sa capacité à expérimenter à l’infini dans le cadre des contraintes les plus limitatives, en l’occurrence ici celles du format chanson.
RabbitInYourHeadlights
14. Portishead - Dummy (UK - 1994)
Muet, on l’est resté en découvrant Mysterons, complainte urbaine résolument moderne sur laquelle la voix en souffrance de Beth Gibbons se posait dans l’espace laissé vacant entre un roulement de batterie martial, un beat hip-hop décharné, une guitare atmosphérique, quelques scratches rachitiques et les échos fantomatiques d’un esprit hanté. Puis ce fût Sour Times, et son groove minimaliste construit autour d’une basse et d’un roulement de cloches trippants samplés sur un morceau de la BO de la série Mission : Impossible signée Lalo Schifrin (Danube Incident, en écoute ici), des accords électriques épurés d’une guitare morriconienne et d’une batterie jazz, pratiquement seuls à habiller ce songwriting vibrant d’une pureté unique, un minimum de moyens pour un maximum d’effet. Et on pourrait continuer comme ça pour tout l’album tant cette première écoute, forcément, a marqué les esprits des novices que nous étions encore en matière de trip-hop, faux genre en perpétuelle évolution dont les prémices trois ans plus tôt avec le génial Blue Lines de Massive Attack étaient encore largement influencées par la musique noire, de la soul au hip-hop en passant par le funk ou le jazz. On pourrait citer d’autres influences aussi (John Barry, le Gainsbourg de Melody Nelson en particulier pour les basses ou Isaac Hayes bien sûr, soulman visionnaire et figure tutélaire des deux groupes, samplé ici sur Glory Box), mais ce serait prendre le risque d’occulter la portée novatrice de cet album et de son alter-ego Protection, tous deux inventeurs chacun à leur manière en 94 d’une soul blanche faite de solitude urbaine et de spleen existentiel. Le reste est déjà de l’Histoire, avec un grand H.
A lire également notre chronique du dernier album Third.
RabbitInYourHeadlights
Lorsqu’il enregistre à la fin des années 60 pour Capitol Records Song Of Innocence puis Songs Of Experience, faux diptyque inspiré par les visions du poète anglais William Blake et ses recueils du même nom, David Axelrod est l’un des producteurs montants du label avec des "poulains" tels que le saxophoniste Cannonball Adderley, le soulman Lou Rawls ou le groupe psyché-rock The Electric Prunes, dont il terminera lui-même les derniers albums après sa dissolution en 68. De jolis succès qui engageront le label à lui laisser les rênes le temps de trois albums visionnaires qui laisseront le public totalement indifférent mais feront de ce musicien inclassable, lequel posait alors sans le savoir les bases du trip-hop, l’un des plus samplés par les têtes chercheuses de l’abstract et du hip-hop dès le milieu des années 90 (de DJ Krush au label Stones Throw en passant par Cypress Hill, Jurassic 5 ou Mos Def), qui l’élèveront par le biais de ces hommages détournés au rang d’artiste culte.
Cinématique, majestueuse, lyrique, anxieuse, mélancolique, spirituelle, baroque, la musique de l’américain, constamment en mouvement, se situe à l’époque à la croisée de celles de Lalo Schifrin (pour les arrangements de cuivres et d’instruments à vent mais surtout la section rythmique, transcendée par la tension urbaine et la liberté mélodique de ces lignes de basse d’anthologie qui représentent aujourd’hui l’essence même de sa formidable modernité) et de John Barry (pour l’ampleur atmosphérique et la portée métaphysique des arrangements de cordes), du jazz modal (pour cette capacité assez extraordinaire à poser une ambiance à partir d’une poignée d’accords de piano downtempo ou de guitare acoustique par exemple) et du rock psychédélique, et parvient à insuffler fraîcheur et invention dans ces différents courants sans vraiment appartenir à aucun d’entre eux (ni forcément, de fait, être reconnu par l’un d’entre eux), avec ambition mais sans jamais tomber dans la grandiloquence du prog (qu’il frôlera élégamment avec ses deux albums suivants) dont les chefs de file aujourd’hui honnis connaissaient alors un succès démesuré tandis que lui-même demeurait dans l’ombre.
Suite à ces deux chef-d’oeuvres d’un classe folle, Axelrod touchera donc à tous les extrêmes avec le passionnant Earth Rot, ode à la nature passant de la pop psyché au free jazz, pour laquelle il expérimentera sur la narration, imprègnera sa musique de mysticisme et de conscience écologique et l’ouvrira au chant d’un choeur délicieusement rétro façon Henry Mancini pour préfigurer paradoxalement les mélodies vocales déconstruites de Gastr Del Sol. Puis, continuant son bout de chemin d’expérimentateur discret, il signera avec Rock Messiah une recréation un peu déconcertante du Messie d’Haydn placée sous le signe d’un gospel funky et orchestral dont les influences classiques donneront néanmoins un superbe hommage néo-classique à la Symphonie pastorale (n°6) de Beethoven, puis renouera doucement avec ses fondamentaux soul/funk/rhythm & blues avec le réussi Heavy Axe, appuyé sur certains morceaux par une chanteuse soul tandis que les instrumentaux de haute volée passent du jazz à la blaxploitation, de l’urgence à la coolitude. Et c’est justement le jazz-funk de ses débuts en solo qui refera surface avec la trilogie Seriously Deep / Strange Ladies / Marchin’, bandes originales de films imaginaires parues entre 1975 et 1980 qui n’ont rien à envier aux Bullitt et autres Dirty Harry de Lalo Schifrin : le premier plus funk et psyché, à l’image de son final Reverie qui préfigure par ailleurs avec sa batterie downtempo et sa basse électrique saturée les ambiances du Mezzanine de Massive Attack, le second plus lyrique avec des arrangements de cordes dignes de Song Of Innocence, tandis qu’un morceau du dernier donnera son nom au Wandering Star de Portishead sur Dummy, préfigurant la coolitude urbaine des rythmiques du groupe avec sa batterie à la croisée du jazz et du hip-hop naissant.
Enfin, redécouvert après 13 ans de hiatus (durant lesquels il enregistrera tout de même trois albums jamais publiés) et un retour ambitieux mais ignoré de la critique comme du public (avec la pièce en quatre mouvements Requiem : The Holocaust en 93) par le docteur ès dénichage de pépites en vinyle DJ Shadow (le piano de Midnight In A Perfect World sur Endtroducing était d’abord celui de The Human Abstract, l’un des sommets avec le touchant The School Boy et l’incroyable The Fly de Songs Of Experience, à découvrir sur myspace), ce dernier le fera signer au tournant des années 2000 sur le label Mo’Wax de son mentor d’alors James Lavelle (leader d’UNKLE dont le morceau Rabbit In Your Headlights sur Psyence Fiction contenait quant à lui un sample du formidable Holy Thursday, morceau séminal de l’oeuvre d’Axelrod extrait de Song Of Innocence ) pour lequel le californien enregistrera un album éponyme dédié à son fils décédé prématurément en 70, revisitant avec brio et une ferveur intacte d’anciens instrumentaux inédits composés en 68 pour les Electric Prunes et interprétés par ses musiciens de studio de l’époque avec de nouveaux arrangements et des collaborations vocales de son vieil ami Lou Rawls et du rappeur Ras Kass, représentant de la jeune garde de ses admirateurs.
RabbitInYourHeadlights
13. GY !BE - Yanqui U.X.O - (Canada - 2002)
Avec Yanqui U.X.O., sommet de post-rock instrumental narratif et cinématique, c’est tout un pan de la musique canadienne qui est plébiscité ici par le forum : l’univers du label Constellation, qui porte on ne peut mieux son nom, ses étoiles brillant d’autant plus fort quand elles sont connectées par des liens plus ou moins tangibles. Des aventureux Do Make Say Think qui phagocytent folk, électronica et jazz, jusqu’au rock torturé et déconstruit de Carla Bozulich, sorte de Patti Smith du côté obscur, en passant par Fly Pan Am et leurs étranges expérimentations au bruitisme funky ou encore Vic Chesnutt, songwriter hanté et figure tutélaire d’une folk américaine déglinguée dont le récent North Star Deserter a trouvé un souffle nouveau et une ampleur inattendue auprès des musiciens d’A Silver Mt. Zion, on a là une concentration de talents comme on en voit rarement.
Un génie de l’ombre, véritable visionnaire effacé devant une oeuvre imposante et sans concession, est au centre de ce bouillonnement créatif : Efrim Menuck, leader de Godspeed You ! Black Emperor et d’A Silver Mt. Zion, et producteur pour de nombreux groupes du label. Sa vision politique et désespérée d’un monde au bord de l’implosion culminera entre 2000 et 2003 avec notamment cet impressionnant Yanqui U.X.O, récit d’apocalypse à la tension de tous les instants, et déjà l’année précédente avec le non moins passionnant Born Into Trouble As The Sparks Fly Upward signé A Silver Mt. Zion, dans lequel un monde s’éteint et renaît de ses cendres, comme purgé du mal sans visage qui le rongeait... celui peut-être de quatre milliards de visages indifférents à l’injustice, la misère, la souffrance et la mort.
RabbitInYourHeadlights
On ne pouvait pas passer à côté de Tim Holland (lire notre récente interview), et ce pour trois raisons évidentes. Tout d’abord parce qu’il est l’initiateur d’Anticon, sans doute le label le plus créatif et passionnant de ces dix dernières années qui a fortement contribué à faire tomber les dernières barrières entre folk, hip-hop, électronica, jazz, shoegaze, post-rock, sunshine-pop (Californie oblige) et même métal (mais on en passe) sous l’impulsion d’un nombre grandissant d’artistes pour beaucoup déjà devenus incontournables dont nous vous donnions l’an dernier un petit aperçu ici.
Deuxième raison et non la moindre, Tim Holland lui-même, sous les pseudonymes de Sole ou Mansbesfriend et avec les projets collectifs Deep Puddle Dynamics et So-Called Artists ou plus récemment le groupe Skyrider ( Sole & The Skyrider Band paru l’an dernier), fait office depuis Selling Live Water de rénovateur numéro 1 du hip-hop, qu’il plie volontiers à son goût des compositions baroques et des ambiances cinématiques, allant même jusqu’à réaliser un album entièrement instrumental en 2007 ( Poly.sci.187, logiquement signé Mansbesfriend, projet autoproduit généralement dédié à ses tentatives les plus aventureuses).
C’est pourtant en tant que Sole que le bonhomme sort Live From Rome en 2005, lequel demeure le sommet de sa discographie déjà bien fournie : flow acéré d’une intensité à fleur de peau, textes à la fois percutants et littéraires capables de mêler dans un même mouvement, puissant et baroque, introspection et regard critique sur un monde devenu arène virtuelle (cf. la pochette) où le pain et les jeux donnés aux uns suffisent à leur faire oublier l’injustice soufferte par les autres, et morceaux à tiroirs formant un véritable labyrinthe mental d’autant plus oppressant que des productions proprement vertigineuses signées Odd Nosdam, Alias, Telephone Jim Jesus ou encore Tepr (le seul extérieur au label, moitié de feu-Abstrackt Keal Agram dont le génial Cluster Ville avait ouvert en 2002 un horizon illimité à l’abstract français), en façonnent les parois sonores extensibles et remodelables à l’infini à coups de drones saturés, de claviers analogiques et de programmations schizophrènes. Ce qui nous amène à la dernière raison, qui s’impose à l’écoute : cet album inépuisable est tout simplement l’un des plus fascinants et novateurs des années 2000.
RabbitInYourHeadlights
12. Joy Division - Closer (UK - 1980)
Comment évoquer Joy Division sans parler du destin de Ian Curtis ? Impossible, tant cette musique sombre et dépressive semble annoncer cette fin inéluctable. Nombre de personnes ont essayé de comprendre cette musique, ces paroles, d’y voir une signification au geste final de ce chanteur charismatique. Mais il n’y aura sûrement jamais de réponse tout au plus quelques indices, quelques signes. Même les ouvrages ou les films aussi réussis soient-ils ne montreront que la surface du personnage dont les pensées resteront à jamais inaccessibles.
En fait, il suffit de se laisser guider et s’abandonner à l’écoute de ces plages obscures traversées par une lumière diffuse et tamisée. Car au travers de ces longues et lentes complaintes, on peut voir une étrange luminosité que l’on devine assez lointaine, sans doute due à la production caverneuse de Martin Hannett. Dans cette obscurité, on est inexplicablement attiré et aspiré par cette lueur au son de cette rythmique tribale, de ces claviers inquiétants, de cette basse lancinante et de ces guitares déchirantes et torturées. On devine le bout du tunnel au fur et à mesure que l’on avance dans les ténèbres de Closer, deuxième et dernier album de la formation mancunienne, un album que l’on peut considérer dans un certain sens comme le testament de son chanteur décédé quelques semaines auparavant. Sur celui-ci, la musique s’étire et ralentit au fur et à mesure que la fin approche, Ian Curtis semble apaisé et résigné malgré ses tourments, sa voix est toujours aussi grave et hypnotique, on l’accompagne les yeux fermés le long de cette descente angoissante et presque rassurante. Il faut le dire, cette oeuvre d’une profonde noirceur reste et restera à jamais unique, une incursion dans un monde inexploré et inconnu que l’on pouvait déjà entrapercevoir sur Unknown Pleasures, cet important premier manifeste engendré sur les cendres du punk. La carrière de Joy Division aussi rapide fut-elle restera ainsi dans les mémoires. La beauté froide et glaciale de son œuvre est toujours aussi mystérieuse et impressionne encore aujourd’hui.
De leur côté, préférant oublier cette atmosphère pesante, les membres du groupe continueront sous un autre nom à savoir New Order qui marquera également de son empreinte les eighties mais dans une veine bien plus dansante avec notamment Blue Monday, l’un des singles les plus marquants et influents de cette époque... mais c’est une autre histoire.
Darko
Un quatre-temps basique pour des accords qui le sont tout autant. Sonnent les premières mesures de Reuters et déjà l’oeuvre est limpide. 21 titres tenant sur à peine 35 minutes. Le temps d’un album et avec des plages de 40 secondes, Wire aura compris ce que Led Zeppelin et autre Jeff Beck mettront 10 ans à essayer de chercher. En vain. A quoi comparer la musique de Wire puisqu’elle ne ressemble alors à rien de connu ? Un Velvet fréquentable qui trainerait avec Television ? Les Ramones qui sortiraient de New York et partiraient à l’assaut de la pluvieuse Albion ? Des Buzzcocks déconneurs ? Trop facile pour le plus insaisissable des groupes punk. Punk ? Ou plutôt même post-punk, Joy Division ou Bauhaus se réclamant par la suite comme ses héritiers.
Le secret de Pink Flag s’il en existe un ? La musique n’est pas jouée, à peine pensée mais simplement vécue. Habitée par une rage à la fois contenue et explosive typique de la jeunesse anglaise d’alors. Elle n’est pas jouée car de toute façon les anglais ne savent pas en faire. Le titre éponyme, parti épique, se termine dans la cacophonie générale et on ne compte jamais plus de quatre accords dans la plupart des morceaux. Pourtant elle est inventive et préfigure le post-rock avec ses tempos lents et ses rythmes lourds ; elle est moderne. Prédit l’après 77 en pleine vague punk. Et la guitare saturée de Pink Flag, le morceau, a dû siffler dans les oreilles de Ride et My Bloody Valentine. Joyeusement débile, Pink Flag reste, 21 ans après, la plus sincère des manifestations juvéniles, énergie adolescente dont les Pixies se serviront largement par la suite. Le plus (le seul ?) honnête manifeste punk. Le miracle ne se reproduira jamais dans la carrière du groupe, toujours en activité sans que cela n’intéresse plus personne. La musique de Wire est éternelle car elle est éphémère.
Casablancas
11. Blonde Redhead - Misery Is A Butterfly (US - 2004)
La grande surprise de ce classement, c’est probablement Blonde Redhead. Aux portes de notre top 10, on n’en revient toujours pas de découvrir ce groupe composé des deux frères jumeaux Simone et Amedeo Pace, nés en Italie, élevés à Montréal et étudiant le jazz à Boston qui ont eu le bonheur de rencontrer dans un restaurant deux jeunes étudiantes japonaises en art dont Kazu Makino. Tout est possible, un peu miraculeux comme la discographie de ce groupe. Repérés en 1993 par Steve Shelley (batteur de Sonic Youth), de la musique aux critiques en passant par les fans, pas un instant on ne les aurait imaginés à l’époque ailleurs que dans la mouvance Sonic Youth ; on a même cru un instant que cette étiquette leur collerait à la peau. Mais le trio habile dans la gémellité finira par s’émanciper, laissant derrière lui 5 albums fort recommandables.
C’est donc avec Misery Is A Butterfly que Blonde Redhead explose, de nouveaux fans débarquent et la mise en scène dévoile une formation adepte de la musique en 3 dimensions : des couleurs baroques étendues, la voix toujours étonnante et haut perchée de Kazu Makino, et une instrumentation multi-pistes pleine de réverb’, il ne nous en fallait pas plus pour être définitivement conquis par cette formation. Entre le feu d’artifice sonore et mélodique de Elephant Woman et la disco-pop enragée d’Equus (elle a mangé du cheval ma parole la petite Makino !), on ne se lasse pas d’entendre au chant tantôt la miss Kazu, tantôt l’un des frères Pace, dans un univers toujours plus arty, toujours plus dense (cf. le dernier album en date 23 ), et avec une production toujours léchée. On s’est vite fait une raison, ce groupe est devenu une référence du 21ème siècle. Et ce n’est pas les robes courtes de Kazu ou le fantasme engendré par ces deux étalons italiens qui iront nous contredire.
Indie
Comment ? Un album live dans cette sélection d’incontournables ? On va se gêner, car en plus de vénérer des étagères pleines à craquer d’albums studio, il nous arrive aussi d’aller courir les chapelles pour entendre et ressentir les plaisirs du concert live. Et quand Dead Can Dance formé du bon samaritain Brendan Perry et de la prêtresse Lisa Gerrard sont en charge de la messe, dieu sait que plusieurs générations se bousculent pour entendre ça. Rassurez tout de même vos proches avant toute écoute, ce groupe a toujours évolué dans la mouvance goth, rock, folk, trad mais qu’ils ne soient pas choqués par ses allures mystiques : toutes ces musiques ne sont que le fruit de nos ancêtres, l’interprétation faite par un anglais et une australienne de sonorités venues des quatre coins du monde. Et si malgré tout il y avait quelques réticences, vous pouvez toujours vous couvrir en citant le nom d’une émission orientée nature/découverte qui vous aurait fait découvrir le groupe, c’est monnaie courante d’utiliser un morceau de Dead Can Dance pour dépayser le téléspectateur.
Tous les chemins mênent donc à Dead Can Dance, ce live officiel se trouve même être le guide parfait pour découvrir le spectre musical et l’aura d’un groupe hors norme. Un appel aux rêves, aux songes, aux voyages et toujours cette drôle d’impression de voir se cotoyer les peuples, la nature, le tout en parfaite harmonie. Dire que Dead Can Dance est l’une des plus belles signatures du label 4AD, vous proposer un extrait du DVD Toward The Within, tout ça parait bien fade pour une oeuvre qui donne envie d’un monde plus avenant. Il vous faudra choisir votre camp, soit vous êtes déjà fan, soit vous partez en quête d’un proche possesseur de ce live, d’un Spiritchaser, Into The Labyrinth ou The Serpent’s Egg, ouvrez grand vos oreilles, fermez les yeux et osez autre chose que le rock à guitares. Une belle ouverture d’esprit, ça s’entretient.
Indie
Un dossier en 10 épisodes : part. 1 - part. 2 - part. 3 - part. 4 - part. 5 - part. 6 - part. 7 - part. 8 - part. 9 - part. 10
Joy Division sur IRM
Blonde Redhead sur IRM - Site Officiel - Myspace
Nick Drake sur IRM - Site Officiel
Portishead sur IRM - Site Officiel - Myspace
Sole sur IRM - Site Officiel - Myspace - Bandcamp
Ennio Morricone sur IRM - Site Officiel
Godspeed You ! Black Emperor sur IRM - Site Officiel
Wire sur IRM - Site Officiel
Dead Can Dance sur IRM - Site Officiel
Chico Buarque sur IRM
David Axelrod sur IRM

- Sulfure Session #1 : Aidan Baker (Canada) - Le Vent Se Lève, 3/02/2019
- Sulfure Session #2 : The Eye of Time (France) - Le Vent Se Lève, 3/02/2019
- Aidan Baker + The Eye of Time (concert IRM / Dcalc - intro du Sulfure Festival) - Le Vent Se Lève (Paris)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
 Ekin Fil - Bora Boreas
Ekin Fil - Bora Boreas Linda Rum - Vienna EP
Linda Rum - Vienna EP MEGGAHCHORDSTACKS & 154 fRANKLIN - The Witches You Didn't Burn EP
MEGGAHCHORDSTACKS & 154 fRANKLIN - The Witches You Didn't Burn EP Francis Gri - Lontano
Francis Gri - Lontano Yzymyr - New Eon
Yzymyr - New Eon Foul Mouth - Everybody Goes Crazy Once
Foul Mouth - Everybody Goes Crazy Once Squanderers - Skantagio
Squanderers - Skantagio DOVS - Psychic Geography
DOVS - Psychic Geography VA - M.A.D. VI
VA - M.A.D. VI Chris Weeks - Familiars
Chris Weeks - Familiars
 |
 |
 |
- L’oeil sur 2025 - 150 albums : #90 à #76 (par Rabbit)
- L’oeil sur 2025 - 150 albums : #105 à #91 (par Rabbit)
- L’oeil sur 2025 - 150 albums : #120 à #106 (par Rabbit)
- DOVS - Psychic Geography
- Squanderers - Skantagio

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
 |
 |